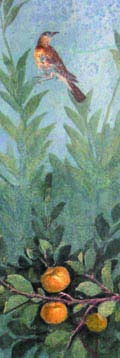
Drôles d'oiseaux...
Editorial, par Vincent Arlettaz
S'il est un paradoxe fascinant dans l'histoire des arts, c'est bien celui-ci: alors que les arts visuels, la peinture et la sculpture, se sont très longtemps fondés -- du moins en Occident -- sur l'imitation de la nature, la musique, tout au contraire, semble n'avoir inventé que des formes originales, dont on chercherait vainement le modèle dans la réalité qui nous entoure. Cette règle n'a guère connu que deux exceptions dignes d'être mentionnées: l'orage et... les oiseaux. Tous deux se retrouvent en effet régulièrement dans les oeuvres musicales, dès le XIIIe siècle au moins, date de composition du canon anglais «Sumer is icumen in», imitant le chant du coucou. A la Renaissance, Clément Janequin développera spectaculairement ce thème dans sa chanson «Le chant des oiseaux», créant une musique descriptive qui restera sans équivalent pendant plusieurs siècles. Daquin (Le coucou pour clavecin) et quelques autres lui feront écho, au moment même où Vivaldi (dans ses Quatre Saisons), Rameau ou Gluck (dans leurs opéras) s'intéressent de près aux bruits de la pluie et de l'orage. Mais c'est surtout l'époque romantique qui mettra les grondements du tonnerre dans son orchestre, avec la Symphonie Pastorale bien sûr, mais aussi de très nombreux poèmes symphoniques et quelques opéras, sans oublier les Saisons du précurseur Haydn. En tout cela, l'imitation reste essentiellement pittoresque et anecdotique, somme toute même sporadique. Que faut-il en conclure? Peut-être bien ceci: que le monde réel a été plus généreux en beautés visuelles qu'auditives, laissant ainsi à l'imagination humaine le champ libre dans le domaine sonore.
Les choses ne changeront qu'au XXe siècle, d'une part avec l'avènement de l'art abstrait, qui devait rompre le lien automatique entre arts visuels et figuratisme; et d'autre part avec l'apparition de l'enregistrement sonore, qui permet d'intégrer aux oeuvres musicales de véritables morceaux de nature. Sans doute n'est-ce pas un hasard si c'est au même moment qu'un Messiaen propose, pour la toute première fois, une musique basée fondamentalement et systématiquement sur un élément naturel: le chant des oiseaux. Mais comme on le découvrira dans le dossier qui suit (voir pages 58-59), sa transposition, bien que rigoureuse, n'est pas réaliste, raison pour laquelle, à l'écoute de ses oeuvres, les différentes espèces dont il a noté scrupuleusement les chants ne sont pas reconnaissables pour un ornithologue; et sa démarche, en dernière analyse, revient à la création de formes nouvelles, originales. En fin de compte, cette nature idéalisée, transposée, traitée de manière abstraite, est-elle très différente de la Nature qu'invoque partout un Rameau, pour légitimer ses théories de la résonance?
Pour lire la suite...
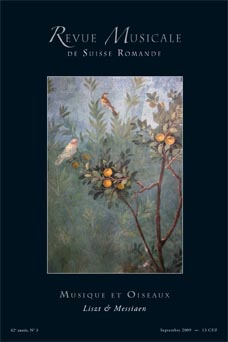
Vous pouvez commander ce numéro 62/3 (septembre 2009, 80 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 4.50 CHF; autres pays: 6.50 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):
(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)
Offre spéciale!
Pour quelques francs de plus, offrez-vous une année complète de Revue Musicale! Abonnez-vous à l'essai pour un an, pour seulement 29 francs suisses (frais de port inclus)* au lieu de 42, soit 30% d'économie, et recevez ce numéro en cadeau! Veuillez envoyer vos coordonnées postales à l'adresse suivante, en précisant le numéro que vous souhaitez recevoir en cadeau:
(* Tarif pour la Suisse, valable seulement pour un nouvel abonné (personne physique uniquement). Tarif pour l'Europe: 42 francs suisses; reste du monde: 49 francs suisses.)
(Pour plus d'informations, voir notre page «abonnement».)
Retour au sommaire du No. 62/3 (septembre 2009)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite