Au fil du temps
Réflexions sur la mise en scène à l'opéra
Par Philippe Junod
On assiste de nos jours à la persistance d'un curieux paradoxe, dénoncé avec brio par Philippe Beaussant dans La Malscène (Fayard 2005).D'un côté, un historicisme parfois sectaire réclame un retour systématique aux instruments d'époque pour l'exécution de la musique ancienne. C'est le cas chez certains «baroqueux». D'autre part, le monde du théâtre, et plus particulièrement celui de l'opéra, semble pris d'une frénésie d'actualisation, pour ne pas dire de modernisation, des représentations. Ces deux tendances contradictoires, archéologisme au concert et modernisme sur la scène, peuvent certes trouver chacune son intérêt dans une pratique raisonnable et raisonnée. Mais tel n'est pas toujours le cas. Et l'on risque d'oublier de part et d'autre que toute perception est conditionnée par une certaine relativité historique.
En effet, nous ne retrouverons jamais l'oreille ou l'oeil de nos ancêtres. Dire, comme on l'a fait pour justifier la «restauration» des peintures de la Sixtine, qu'on allait les revoir comme les avait vues Michel-Ange, est d'une désarmante naïveté: c'est oublier qu'à l'époque l'éclairage électrique n'existait pas, mais surtout que toute vision est orientée par sa mémoire, et que la nôtre est enrichie ou déformée par cinq siècles d'histoire de l'art qui nous séparent des fresques. Transposée dans le domaine de la musique, la question se pose dans les mêmes termes. On peut dire que notre écoute du clavecin n'est plus celle des Couperin, de Rameau ou de Scarlatti puisque de nos jours cet instrument est inévitablement comparé au piano, qui l'a si souvent remplacé. Jouer Bach sur un Steinway est donc parfaitement justifié, et ceci pour plusieurs raisons. Le piano est pour nous ce qu'était alors le clavecin, c'est à dire l'instrument à clavier le plus courant, tandis que celui-ci connote aujourd'hui une sensation d'archaïsme absente au XVIIIe siècle. Il faut rappeler aussi que les transpositions instrumentales étaient fréquentes à l'époque, et que Bach en a laissé quelques exemples célèbres. On peut penser enfin que lui-même, ayant eu l'occasion de tester les premiers forte-pianos, a pu s'en inspirer lorsqu'il a composé sa Fantaisie chromatique par exemple. Or, là où les puristes inconditionnels de la pratique des instruments anciens font fausse route, c'est lorsqu'ils s'obstinent à jouer sur ceux-ci des oeuvres composées au XXe siècle (Falla, Frank Martin, Bartók ou Ligeti par exemple) sous le prétexte que le clavecin Pleyel, inventé par Wanda Landowska, et pour lequel ces pièces furent écrites, est un monstre. Le risque de cet anachronisme paradoxal, ou «archéologisme à l'envers», est que l'instrument ancien devienne inaudible dans un ensemble moderne, comme dans le cas de concertos, voire de la Symphonie concertante de Frank Martin, où le clavecin dialogue avec le piano, qui ne peut alors que le couvrir. Point n'est donc besoin de se coiffer d'une perruque pour jouer Bach, ni de peupler le plateau de colonnes antiques pour déclamer Racine. Mais dire que les chefs-d'oeuvre du passé doivent être actualisés pour passer la rampe, c'est d'abord les priver de leur dimension universelle en leur imposant une actualité factice, qui ne peut être qu'éphémère. Et c'est surtout mépriser à la fois leurs auteurs, qui n'ont pas besoin de cette béquille, et le public, qui n'est pas toujours aussi stupide que l'on croit.
Piscines, motos et feux rouges
L'ironie ravageuse et désopilante de La Malscène mérite, dans son genre, de rejoindre au panthéon des classiques les Great Operatic Disasters de Hugh Vickers (1979) ou Une nuit à l'opéra des Marx Brothers (1935). Mais depuis lors, le sottisier n'a pourtant pas manqué de s'enrichir, et l'on ne résiste pas à en donner ici quelques exemples: des dieux descendant de l'Olympe avec des skis sur l'épaule; une Pénélope tirant à l'arc (un vrai, sur une vraie cible) dans le Retour d'Ulysse; des saltimbanques, jongleurs et acrobates s'agitant pendant l'air de la mort de Didon; un ours blanc ponctuant chaque scène d'un opéra italien; des chanteurs les pieds dans un pédiluve pendant tout le troisième acte de Tristan. Et que dire d'un acteur «porno» engagé pour le Venusberg de Tannhäuser à Genève ou de la Carmen féministe et assassine de Leo Muscato à Florence? Succès et scandale garantis. Les deux termes seraient-ils devenus synonymes? Mais la provocation comme procédé finit par être ringarde...
Pour lire la suite...
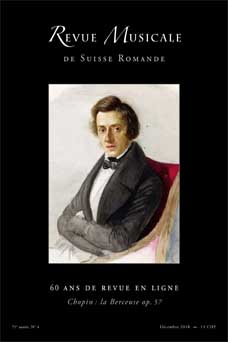
La version gratuite de cet article est limitée aux premiers paragraphes.
Vous pouvez commander ce numéro 71/4 (décembre 2018, 64 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):
(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)
Retour au sommaire du No. 71/4 (décembre 2018)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite