Ravel selon Ravel
Deux mots sur 'Miroirs', 'Jeux d'eau' et
la 'Pavane pour une infante défunte'
Par Vincent Arlettaz
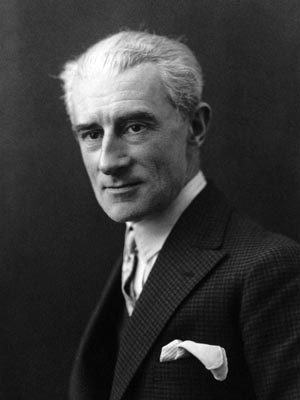
Fig.1: Maurice Ravel (1875-1937) en 1925.
Dansl'espace d'une demi-douzaine d'années qui s'écoule entre la composition de la Pavane pour une infante défunte (1899) et celle de Miroirs (1906), le style musical de Maurice Ravel (1875-1937) aura passablement évolué, atteignant rapidement une sorte de première maturité. Cette période est celle où la proximité artistique avec Claude Debussy est sans doute la plus grande, avant qu'une certaine distance ne s'installe finalement entre les deux maîtres; c'est aussi à propos de ces années que les commentateurs sont le plus tentés de rattacher l'esthétique de Ravel à l'impressionnisme -- concept dont l'application à la musique, comme nous allons le voir bientôt, ne va pas sans poser d'épineux problèmes. Une oeuvre en particulier, à peu près à mi-distance entre la Pavane et les Miroirs, paraît centrale à cet égard: les fameux Jeux d'eau (1901), qui firent beaucoup pour établir la réputation du jeune compositeur.
Beaucoup a été écrit sur la question; nous proposons aujourd'hui de parcourir ces années cruciales en compagnie de Ravel lui-même et de ses proches, c'est-à-dire en donnant la parole à leur correspondance ou à leurs souvenirs -- ceux, notamment, d'une Marguerite Long, d'une Hélène Jourdan-Morhange ou d'un Vlado Perlemuter, interprètes de référence qui recueillirent du compositeur lui-même les traditions d'exécution de ses oeuvres.
Pavane pour une infante défunte (1899)
Ravel a vingt-quatre ans lorsqu'il compose la Pavane pour une infante défunte, qui le rendit rapidement célèbre. De style complètement différent, les Jeux d'eau, écrits seulement deux ans plus tard, auront pour leur part un impact considérable sur un public plus connaisseur, comprenant notamment compositeurs et pianistes. La distance qui sépare ces deux oeuvres -- aussi bien au niveau de l'esthétique que pour ce qui concerne leur réception -- nous frappera davantage encore si nous nous souvenons que toutes deux ont été créées simultanément, en avril 1902, par Ricardo Viñès. En 1910, Ravel orchestre sa Pavane, qui deviendra un incontournable des concerts symphoniques jusqu'à ce jour. Quant au destin remarquable des Jeux d'eau, Marguerite Long, future dédicataire du Concerto en sol l'évoque pour nous:
«Les Jeux d'eau pour leur part déchaînèrent l'enthousiasme dans les conservatoires. A peine avais-je eu moi-même le temps d'en prendre une connaissance admirative que les élèves me réclamaient de les travailler. Comme ils avaient raison d'accueillir triomphalement ce renouveau d'une technique du piano sensiblement demeurée en sommeil depuis Liszt! Pourtant, Ravel n'a point perçu dès l'instant tout ce qu'il offrait à la gloire du clavier et il exprima à l'éditeur Demetz son étonnement d'un aussi franc succès. Plus tard il reconnut que les Jeux d'eau, parus en 1901, sont à l'origine de toutes les nouveautés pianistiques qu'on a voulu remarquer dans son oeuvre.»
Fidèle à sa légendaire réserve, le compositeur aura surtout une réaction épidermique de rejet pour la Pavane, rapidement suspectée (comme le sera plus tard le Boléro) d'être trop accessible, et d'occulter injustement d'autres recherches, pour lesquelles il aurait souhaité davantage de reconnaissance. Loin de s'apaiser avec le temps, cette aversion devait se maintenir sur le long terme, et Ravel aura constamment les mots les plus durs pour cette pièce -- acharnement difficile à comprendre en vérité, et dont l'évidente partialité nous permet de n'en pas tenir compte. Ainsi, en 1912, devant rédiger la chronique d'une série de concerts au cours desquels la Pavane a été entendue, notre compositeur signe cet incroyable paragraphe:
«Je n'éprouve aucune gêne à en parler: elle est assez ancienne pour que le recul la fasse abandonner du compositeur au critique. Je n'en vois plus les qualités, de si loin. Mais, hélas! j'en perçois fort bien les défauts: l'influence de Chabrier, trop flagrante, et la forme assez pauvre. L'interprétation remarquable de cette oeuvre incomplète et sans audace a contribué beaucoup, je pense, à son succès.»
Ce dédain quelque peu maniéré nous sera d'ailleurs confirmé, bien plus tard, par les souvenirs de Vlado Perlemuter, qui travailla intensivement avec Ravel dans les années 1927-1929; à la question d'Hélène Jourdan-Morhange, Perlemuter répond en ces termes:
«Vlado, Ravel vous a-t-il donné des conseils pour cette Pavane?
«V.P. -- Non, quand je la lui ai apportée, il a fait la grimace et m'a dit: «Ah! vous avez travaillé ça?» Cela ne l'intéressait pas...»
L'oeuvre figurait pourtant au programme des trois masterclasses -- les seules de toute sa vie -- que Ravel donna en juin 1925 à l'Ecole Normale de Musique de Paris; dans ce qui nous reste de ses notes de cours, les remarques sur cette partition sont certes assez succinctes; elles prouvent néanmoins que Ravel n'était pas sérieusement hostile à l'idée de son exécution:
«Pavane pour une infante défunte [...]. -- Ne pas attacher au titre plus d'importance qu'il n'en a; éviter de dramatiser. Ce n'est pas la déploration funèbre d'une infante qui vient de mourir, mais l'évocation d'une pavane qu'aurait pu danser telle princesse, peinte par Velásquez jadis, à la Cour d'Espagne. Donc, un caractère grave, un peu mélancolique, mais qui reste celui d'une danse lente.»
Ces observations sont d'ailleurs confirmées par les notes d'une auditrice anonyme de la même masterclass:
«Cette pavane a été inspirée par un portrait de jeune fille par Velásquez au Louvre. Son titre, disait Ravel, est purement littéraire: et il ne faut pas croire que c'est une pavane pour être jouée devant un cadavre! C'est une infante morte il y a très longtemps et c'est sa pavane qu'elle dansait à la cour. Ce doit être pompeux, et sans aucune expression ou sentimentalité, Ravel a bien appuyé là-dessus.»
Sentimentale, la Pavane pour une infante défunte l'est pourtant, et même au plus haut point. Inutile donc, pour l'interprète, de se perdre en surenchère -- et l'on peut, sur le fond, donner raison au compositeur. Nul doute que l'autocritique de ce dernier, très exagérée, constitue surtout une façon de réclamer plus d'attention pour d'autres créations, certainement moins accessibles. Que penser, en somme, de la Pavane? «Je continue à trouver cette danse lente et grave non dépourvue de charme», nous dit Marguerite Long. Osons aller plus loin, et la qualifier de sublime, dans sa simplicité même; l'erreur serait toutefois de vouloir la rattacher au Ravel ultérieur, et de la forcer à entrer dans le cadre d'un impressionnisme dont l'heure, le concernant, n'est pas encore venue. C'est bien plutôt du côté de Fauré (et non de Chabrier, n'en déplaise à Ravel lui-même) que l'on pourra chercher un modèle à sa transparente élégance; n'oublions pas que la Pavane du même Fauré, à la démarche harmonique somme toute très similaire (comme le montre par excellence le dessin des deux lignes de basse, où les quintes sont omniprésentes), avait été composée en 1887, soit douze ans plus tôt. Ravel sut habilement s'en démarquer en augmentant son titre d'une poétique allitération («infante défunte») qui fit sans doute beaucoup pour alimenter le mystère et renforcer sa séduction -- les Impressionnistes n'avaient-ils pas fait de même pour leurs tableaux? Le fameux Impression soleil levant de Claude Monet, rappelons-le, avait d'abord été baptisé Vue du Havre -- titre qui ne l'aurait sans doute jamais porté aux sommets...
Pour lire la suite...
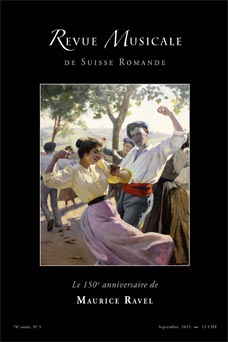
La version gratuite de cet article est limitée aux premières pages.
Vous pouvez commander ce numéro 78/3 (septembre 2025, 64 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):
(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)
Retour au sommaire du No. 78/3 (septembre 2025)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite