Pour les 75 ans de la Revue
Par Vincent Arlettaz
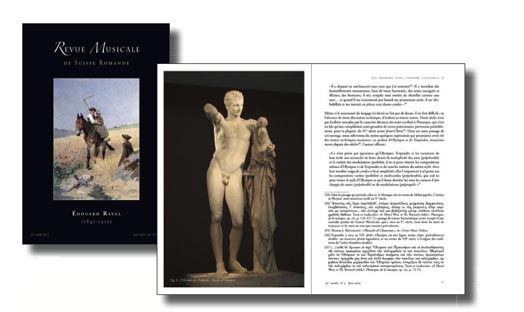
Créée en mars 1948 sous l'appellation 'Feuilles Musicales', notre revue a adopté son titre définitif en 1963, et fête aujourd'hui ses 75 ans; magnifique longévité, que nombre de périodiques -- et pas seulement des revues culturelles -- peuvent désormais nous envier. En trois générations, pas moins de 16'000 pages auront ainsi été consacrées aux richesses de notre art, dont largement plus de mille au cours des cinq dernières années.
Si, par le passé, les périodes d'épreuve n'ont pas manqué, le lustre que nous venons d'ajouter à notre histoire aura été, de toute évidence, l'un des plus ardus à conquérir. La suspension à peu près totale de notre vie culturelle, de mars 2020 à juin 2021, puis les répercussions profondes et durables de ce traumatisme d'un genre inédit, auront pesé de tout leur poids sur notre entreprise, comme sur l'ensemble du milieu artistique. Dans ces circonstances, nous sommes particulièrement heureux et fiers d'avoir mené la Revue Musicale jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui; et plus heureux encore d'avoir pu continuer à proposer, dans l'ambiance mortifère qui se développait alors, une vision où la beauté et l'émotion conservaient leur place centrale, que même la peur ne saurait leur contester. S'ils n'ont pas toujours été compris de tous, de tels choix ont aussi, nous le savons, apporté du réconfort à nombre de nos lecteurs; et cette légitimation, nous l'avouerons, est entièrement suffisante à nos yeux.
Dans l'insolite expérience du confinement, nous avons bénéficié, il est vrai, d'une circonstance favorable; depuis ses origines en effet, le profil de notre publication est double, notre contenu s'articule selon deux axes principaux: d'une part les articles de fond, consacrés à des sujets d'histoire de la musique ou d'analyse des oeuvres; et d'autre part, notre rubrique d'actualités. Cette dernière étant profondément impactée, le choix évident aura été d'amplifier, par compensation, la part dévolue aux textes plus atemporels.
Un nouvel équilibre
Bien qu'il corresponde pleinement à nos traditions, un tel effort n'aura pas été non plus toujours de tout repos: non seulement une énergie particulière a dû être mobilisée pour concevoir de nouveaux projets en nombre et en volume suffisant, mais de surcroît, la règlementation sanitaire aura rendu parfois épineuse la question de l'accès aux sources d'information; ce fut le cas notamment au printemps 2020, où les bibliothèques sont restées totalement fermées pendant plusieurs mois; puis durant le trimestre d'hiver 2021-2022, lorsque les chercheurs non «vaccinés» furent bannis des mêmes bibliothèques -- étrange situation qui, fort heureusement, ne perdura pas. Nous avons alors pu mesurer à quel point les ressources en ligne, incontournables aujourd'hui pour toute recherche scientifique, sont encore loin d'être suffisantes néanmoins; et si les livres anciens, les grandes encyclopédies musicologiques et plusieurs périodiques internationaux sont désormais disponibles sur internet (notamment grâce à nos hautes écoles, qui souscrivent à de dispendieuses bases de données), il reste impossible de consulter de cette façon la quasi-totalité des livres récents, ainsi que de nombreuses revues de grande valeur. Au final toutefois, il semble que ces difficultés ne se perçoivent pas à la lecture des articles de fond que nous avons publiés entre mars 2020 et l'été 2022; l'exercice nous paraît donc réussi: le sommet de l'art n'est-il pas de donner, quelles que soient les circonstances, l'impression de la facilité?
Parmi les projets qui pourraient être de nature à durer, nous citerons ici la série de trois articles sur les grandes épidémies du passé, et leur rapport à l'histoire des arts (fig. 2): ainsi la Peste d'Athènes (430 av. J.-C.) précède-t-elle de peu l'invention de la peinture illusionniste, que nous appelons «trompe-l'oeil», et que les Grecs désignaient du nom de «peinture d'ombres» («skiagraphie»); nous savons que la musique, à la même époque, a subi d'importantes réformes, initiées notamment par le citharède Timothée de Milet; notre hypothèse -- qui rompt avec la tradition musicologique des deux derniers siècles -- est que ces bouleversements ont quelque chose à voir avec l'introduction de la musique à sons simultanés (juin 2020). Cette même innovation, la polyphonie, aurait été transmise au Moyen Age par l'intermédiaire des Byzantins -- avec l'orgue, qui en fut certainement un vecteur privilégié, et que la tragique rupture que fut la Peste de Justinien (541 ap. J.-C.) ne parvint pas à faire oublier (septembre 2020). Enfin, la Peste Noire du XIVe siècle n'a en rien freiné le développement prodigieux de la peinture et de la musique, que Français et Italiens portent dès cette époque à un degré de raffinement remarquable (décembre 2020). Ces trois cas nous montrent que les catastrophes sanitaires, si elles ont eu des conséquences profondes et durables sur la démographie, la société et l'organisation politique de toute l'Europe, n'ont en rien entravé le progrès des arts, qu'elles auront peut-être même, parfois, accéléré.
L'interdisciplinarité
Cette série sur les épidémies, accordée aux préoccupations du temps, reposait sur une démarche fortement marquée par l'interdisciplinarité; une telle tendance n'était toutefois pas véritablement nouvelle, concernant notre revue: on pouvait déjà l'observer en effet dans les années précédentes; et il est probable que, même sans pandémie, la revue se serait de plus en plus inscrite dans cette perspective. D'autres de nos publications pourront illustrer ce point, par exemple les deux articles du Professeur Philippe Junod sur le Musicalisme, mouvement pictural étroitement connecté à notre propre art (mars 2021 et 2022); ou encore les essais portant sur des sujets d'origine littéraire, comme Don Quichotte en musique (mars 2022; fig. 4); nous avons d'ailleurs ouvert récemment une autre «mine» au filon très prometteur, explorant les mises en musique de Virgile et Homère. Enfin, entre deux vagues de confinement, en juin 2021, nous nous sommes même permis le luxe d'expérimenter dans le domaine de la vidéo, en nous associant aux Jeunesses Musicales suisses pour la production d'un DVD consacré à de jeunes artistes ou à des répertoires peu pratiqués (Ernest Chausson, Clara Schumann, W. Typp, Charles Lecoq...). Au cours des quinze dernières années, nous avions déjà, par deux fois, publié un disque audio (mars 2008: Les Musiques de la cour de Savoie; juin 2013: Avignon, musique au Palais des Papes), mais le domaine de l'image filmée nous était encore inconnu. Le savoir-faire acquis à cette occasion pourrait d'ailleurs, selon l'évolution de notre situation générale, notamment financière, servir encore à l'avenir, pour de nouveaux et enthousiasmants projets...
Pour lire la suite...
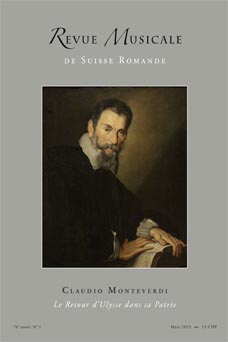
La version gratuite de cet article est limitée aux premiers paragraphes.
Vous pouvez commander ce numéro 76/1 (mars 2023, 69 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):
(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)
Retour au sommaire du No. 76/1 (mars 2023)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite