La galère des festivals français
ou l'été par intermittences
par Antoine Pecqueur et Vincent Arlettaz
Décidément, l'été 2003 aura été chaud. Chez nos voisins français, ce ne sont pas seulement les forêts qui ont pris feu: Aix, Avignon annulés, Orange chahuté, les festivals sont dans la tourmente. Au centre du problème: le statut des «intermittents du spectacle», menacé depuis des mois, et qui a fait l'objet au début de l'été d'une réforme rejetée par une grande partie des syndicats. Mais pourquoi n'a-t-on pas pu éviter le pire, et qu'est-ce, en fait, qu'un «intermittent du spectacle»?
Un statut unique en Europe
Le statut français des «intermittents du spectacle» est unique en Europe. Dans les autres pays, artistes et techniciens du spectacle sont considérés comme des travailleurs ordinaires. Créé par le Front Populaire en 1936, et destiné à donner aux artistes les moyens d'exercer une activité continue malgré le caractère souvent saisonnier et éphémère de leur profession, ce statut a été confirmé et élargi au cours des décennies suivantes, pour s'appliquer également à l'audio-visuel et aux personnels techniques (1965 et 1968); il a surtout donné lieu à la création d'un régime spécial d'indemnisation pour les périodes chômées (1958). Ce régime, plus souple que le régime général, prévoyait jusqu'ici qu'il fallait justifier d'un minimum de 507 heures de travail (ou 43 «cachets») au cours des 12 mois précédents pour prétendre aux prestations de ce régime spécial. Diverses mesures (délai de carence) ont été par ailleurs prévues pour que les artistes ayant le mieux gagné leur vie dans ce délai d'une année ne perçoivent pas des indemnités «exorbitantes»..
Le grand avantage du système des intermittents, c'est qu'il permet de maintenir en activité une importante population de travailleurs qualifiés, spécialisés dans les métiers du spectacle, et rapidement disponibles. C'est là assurément un élément de poids dans le domaine de la production artistique. Mais ce régime spécial n'est pas financé par les pouvoirs publics: il est pris en charge par le régime général de la caisse de chômage (Assedic), c'est-à-dire par les cotisations de tous les travailleurs, tous secteurs d'activité confondus -- au nom du principe de solidarité. Et c'est bien là que se situe le problème: entre 1991 et 2001, le nombre des bénéficiaires du régime spécial aurait doublé (il se situerait actuellement entre 60 000 et 100 000 selon les sources), et le déficit qu'il occasionne aurait triplé dans le même temps...
Pour lire la suite...
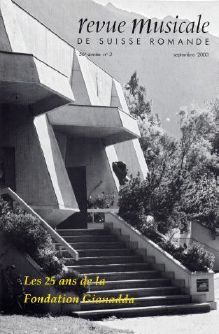
Vous pouvez acheter la version imprimée de ce numéro pour 9.50 CHF (plus participation aux frais de port). Plus d'informations sur notre page «Archives)»
Retour au sommaire du No. 56/3 (septembre 2003)
© Revue Musicale de Suisse Romande
Reproduction interdite